Je, tu, il/elle procrastine …
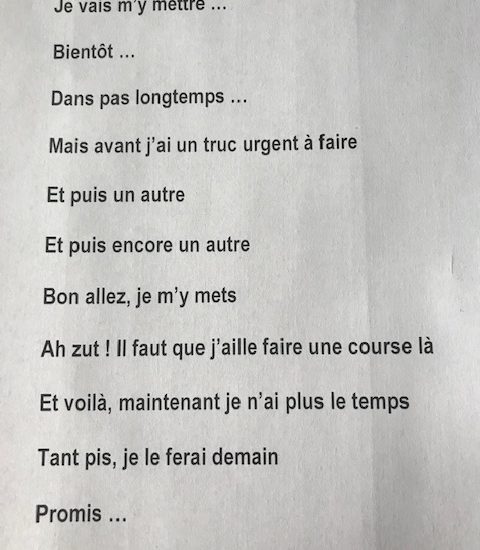
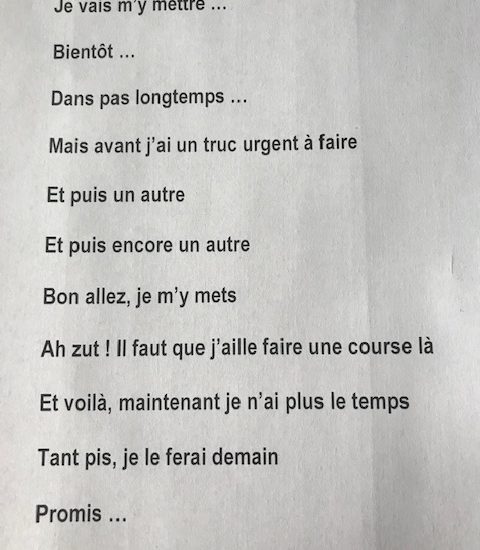
Quel meilleur sujet que la procrastination pour reprendre ce blog ? Voilà en effet des mois que je l’ai abandonné. Des semaines que j’ai envie d’y revenir. Des jours que je pense à le faire. Et des heures que je tourne autour …
C’est exactement ça la procrastination : expérimenter son propre rapport au temps et, souvent, remettre au lendemain (« crastinus » en latin) ce qu’on pourrait faire le jour même. En tout cas, c’est la définition commune. Pour un philosophe comme Aristote, ce serait plutôt de l’ « acrasie », c’est-à-dire un manque de maitrise de soi, un échec de la volonté allant à l’encontre de son meilleur jugement. Pour les psychologues, c’est un retard inutile mais volontaire malgré des conséquences potentiellement négatives. Et pour les économistes, c’est un comportement irrationnel, puisqu’il conduit à retarder un bénéfice immédiat malgré un coût équivalent.
Sauf que … sauf que nous ne sommes pas toujours des êtres rationnels. Prenons un exemple – au hasard : ma chère et tendre. Après avoir reçu une amende, Marie ma compagne a(vait) en effet la fâcheuse habitude de retarder encore et encore son règlement. Jusqu’à parfois garder la lettre dans son sac et la poster si tard que l’amende en soit majorée ! Un travers qui a(vait) le don de m’énerver, moi qui à l’inverse aurais plutôt tendance à m’en débarrasser au plus vite pour passer à autre chose.
Pourquoi Marie met-elle autant de temps à poster sa lettre alors que, elle le sait, cela risque de lui coûter plus cher ? Pourquoi ai-je eu autant de mal à commencer ce post alors que, j’en suis conscient, je serai heureux quand je l’aurai fini ? Pourquoi certains laissent-ils trainer des jours durant des assiettes sales dans l’évier quand d’autres font la vaisselle dès la fin du repas ? Que peut-il bien se passer dans notre cerveau au moment même où nous procrastinons ainsi ?
Une équipe de chercheurs a trouvé la réponse ! Ses travaux ont été publiés récemment dans Nature Communication : rien que du sérieux, 25 pages bien denses avec des phrases du style « Pour corriger tout bruit spécifique au sujet dans les données d’IRMf qui pourrait corrompre les estimations de régression, nous avons normalisé ces bêtas par le niveau d’activation global (poids bêta du choix de modélisation du régresseur catégoriel) ». Vous ne comprenez rien ? C’est normal car l’étude mêle allègrement statistiques pures, imagerie de haute précision et tests comportementaux.
Rassurez-vous, je vais vous expliquer. Concrètement, cette équipe a recruté 51 volontaires. Elle leur a d’abord demandé d’attribuer, de façon subjective, une valeur à certains efforts (faire des pompes, remplir une demande de renouvellement de passeport …) et aux récompenses correspondantes (des gâteaux, de l’argent …).
Puis elle leur a proposé deux tests. Dans le premier, les participants devaient décider entre le « couple » petit effort/petite récompense maintenant et grand effort/grande récompense plus tard. Dans le second test, ils devaient remplir la demande de renouvellement dans un délai d’un mois pour obtenir la récompense promise.
Première observation : le coût d’un effort est plus élevé s’il est accompli maintenant que plus tard. Dit autrement, « le cerveau réduit l’effort avec le temps » expliquent les scientifiques.
Deuxième observation : les participants se révèlent « plus impulsifs avec l’effort et plus patients avec la récompense ». Du coup, reporter une tâche devient bénéfique puisque l’effort est diminué sans que la récompense soit dévalorisée.
Troisième observation – et là, ça devient passionnant : grâce à l’imagerie, les chercheurs ont découvert que la zone du cerveau qui s’allume pour la récompense est différente de celle pour l’effort ! Or, chez certains, cette dernière zone est particulièrement sensible, plus active en quelque sorte que la première.
Voilà pourquoi les procrastinateurs procrastinent. Ils ont beau savoir qu’ils seront récompensés, cette promesse ne pèse pas lourd par rapport à l’énergie que cela leur demande. Et même la perspective d’une punition éventuelle, connue, ne suffira pas davantage à les motiver. Car ils sont dans « l’incapacité à réguler les réponses émotionnelles à l’aversion pour une tâche » constatent les scientifiques.
A moins que. A moins que cette punition ne devienne, le temps passant, une réalité. Car alors la balance coût/bénéfices s’inverse peu à peu : l’effort semble moindre (cf. première observation) tandis que la récompense – entendue comme une non punition – ne peut plus être différée (cf. deuxième observation).
Mais cela, me direz-vous, ça marche quand il y a un délai bien précis. Sans obligation temporelle, le risque de différer encore et toujours est grand. C’est vrai. D’ailleurs, concluent les chercheurs, si le participant « commence avec une faible probabilité de terminer le premier jour, il y a de fortes chances que la tâche ne soit jamais réalisée ».
Heureusement que l’être humain ne se réduit pas à une pure statistique. La preuve : j’ai fini par l’écrire, ce post de blog !







