Burn out : vraie ou fausse maladie ?
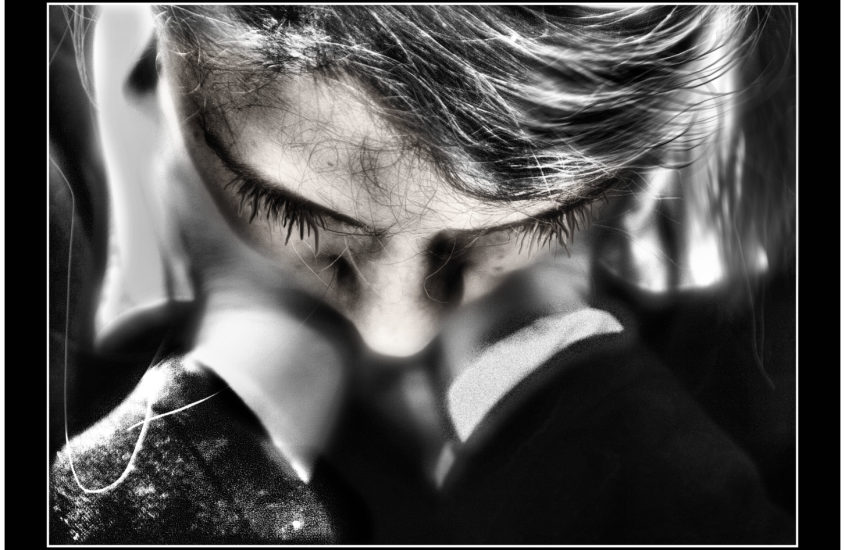
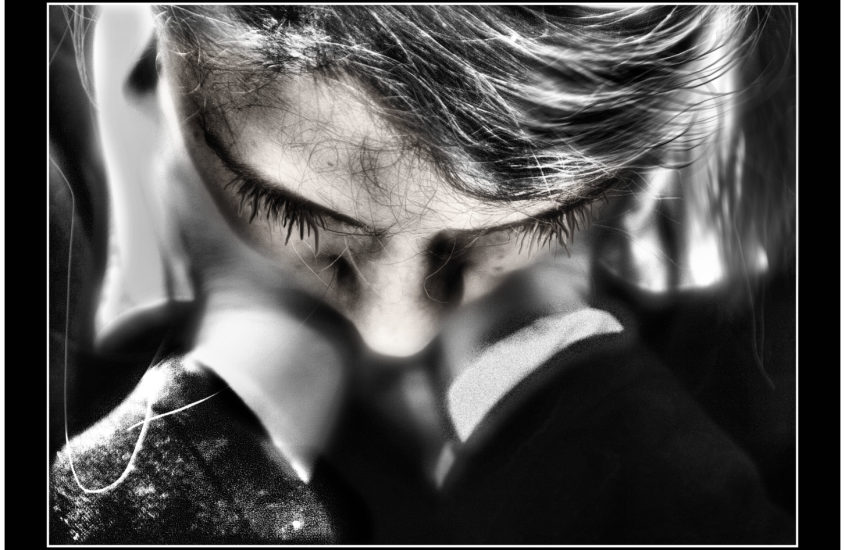
Le burn out est-il une maladie à proprement parler ? Je déplorais dans mon post précédent l’attitude de l’Académie de médecine qui voyait dans certains chiffres (3 millions de victimes) une estimation « à prendre avec des pincettes », dénonçant de ce fait une trop grande « confusion » autour du terme même de burn out. Cela dit, l’Académie soulevait au passage un point intéressant : comment inscrire le burn out comme une maladie professionnelle, sans définir au préalable en quoi elle est une maladie ? Une maladie, je le rappelle, se définit à partir d’un diagnostic, d’un pronostic et d’une stratégie thérapeutique.
Le diagnostic
De fait, le tableau clinique d’un burn out est complexe. Sur le plan symptomatologique, il existe au moins 4 critères communs : un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation, une non reconnaissance dans le milieu professionnel et une fatigue importante et durable.
Sur le plan biologique, la situation est tout aussi complexe : au niveau cérébral on constate, comme dans les dépressions sévères, un déficit de régulation du taux de cortisol dans le sang ; au niveau immunitaire on constate, comme chez les patients en stress chronique, des anomalies inflammatoires ; au niveau organique on constate, comme chez les victimes de syndrome de stress post-traumatique, une baisse de certains facteurs trophiques.
Le pronostic
Là encore, il est complexe, très variable d’un individu à l’autre et, surtout, difficile à établir en l’absence de critères précis de sortie de la maladie (est-ce la fin de la fatigue ? l’arrêt des traitements ? le retour au travail ? temporaire, définitif ? aménagé, à temps plein ?).
La thérapeutique
Concrètement, les médecins sont démunis. Le plus souvent, la prise en charge se résume à des antidépresseurs ou à des anxiolytiques, alors qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une dépression ni d’un stress post traumatique. Quant à la psychothérapie, elle est sans aucun doute très utile mais elle n’est pas non plus spécifique d’un burn out.
Un diagnostic peu évident, un pronostic délicat, des traitements non adaptés… On comprend dans ces conditions que la médecine se sente parfois impuissante devant une victime de burn out. Et qu’elle ait du mal, du coup, à en faire un « vrai » malade.
Nonobstant les obstacles méthodologiques (réels) et les réticences (compréhensibles) de certains spécialistes, je maintiens pour ma part que le burn out est bien une maladie. J’en veux pour preuve le fait que toutes les victimes d’un burn out racontent peu ou prou la même expérience : un jour, elles, jusque là si impliquées dans leur boulot, se découvrent physiquement et psychiquement incapables d’aller travailler. Sans comprendre ce qui leur arrive. Sans explication à donner. Sans ressource personnelle. Dans un état d’épuisement tel que toute action, même un simple coup de fil, est au dessus de leurs forces. Elles sont littéralement « cramées » de l’intérieur. Et elles mettront des mois à s’en remettre.
Je propose donc la définition suivante : le burn out se caractérise par un effondrement psychique foudroyant, massif – jusqu’à la sidération. Cet effondrement est en lien direct avec une activité professionnelle. Il est imprévisible, sans cause organique, sans facteur extérieur identifiable et sans signe avant-coureur spécifique. Cette définition conviendrait-elle à l’Académie ? J’aimerais bien avoir sa réponse.








Commentaires
Trackbacks & Pingbacks
[…] Comment inscrire le burn out comme une maladie professionnelle, sans définir au préalable en quoi elle est une maladie? Une maladie, je le rappelle, se définit à partir d’un diagnostic, d’un pronostic et d’une stratégie thérapeutique. LEXPRESS.fr – Science et Santé […]
[…] flickr/tigerzeyeLe burn out est-il une maladie à proprement parler ? Je déplorais dans mon post précédent l’attitude de l’Académie de médecine qui voyait dans certains chiffres (3 millions de victimes) une estimation » à prendre avec des pincettes « , dénonçant de ce fait une trop grande » confusion » autour du terme même de burn out. […] Lire la suite… […]