Coronavirus : les marchés, le foot, le Louvre… et puis quoi après ?
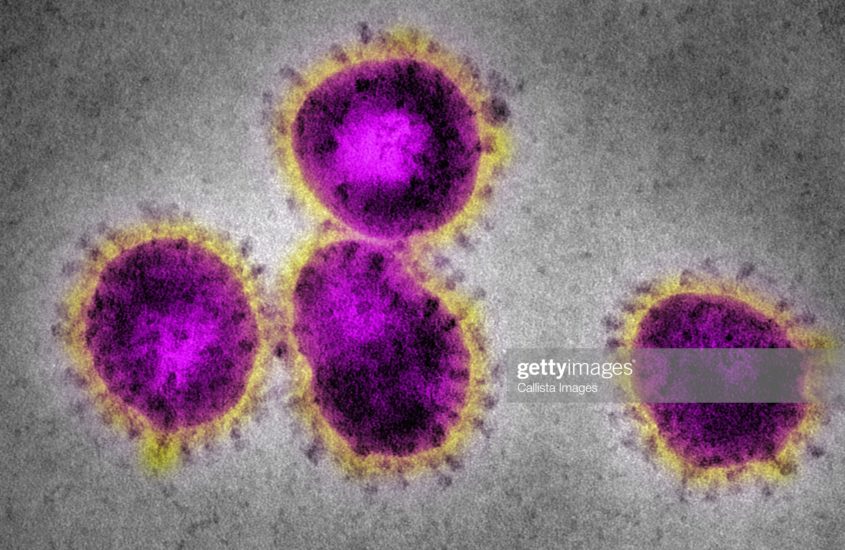
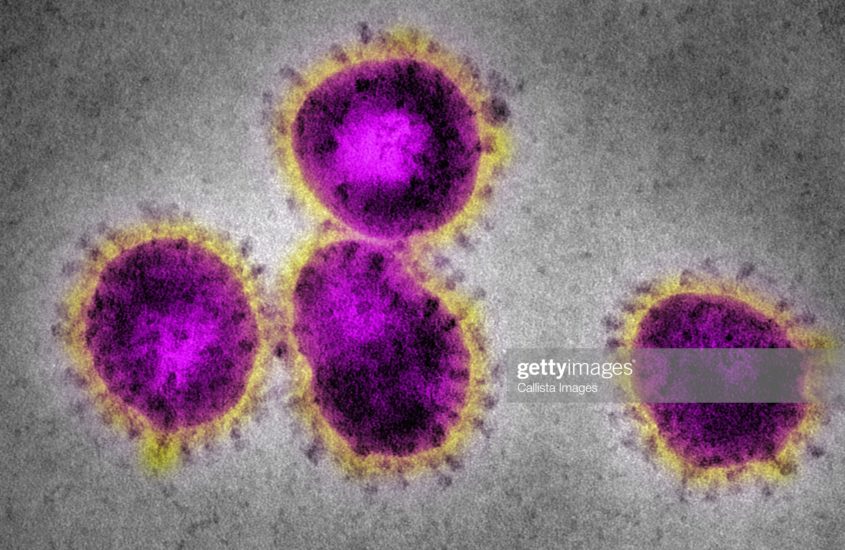
Je suis très énervé ! Oui, je commence à en avoir assez de voir des « experts » (éditorialistes, sociologues, politiques, commentateurs en tous genres) parler du coronavirus et se répandre dans les médias – les chaines d’info continue en particulier – sans avoir la moindre notion d’épidémiologie ou de santé publique.
Ils n’y connaissent rien ? Cela ne les empêche pas de donner leur point de vue « éclairé », sans crainte de se contredire. Se féliciter que le gouvernement évolue selon les événements. Et lui reprocher dans la foulée son manque de constance. Ou l’inverse. Sans hésiter non plus à expliquer dans une même phrase que « on » en fait trop mais que « on » n’en fait pas assez. Lundi soir, j’entendais encore un de ces spécialistes auto-proclamés affirmer doctement qu’il ne servait à rien de porter un masque dans la rue… pour regretter dix secondes plus tard la pénurie de masques dans les pharmacies.
Informer sans paniquer : l’équilibre à tenir par les pouvoirs publics est délicat. Très délicat, puisque la conjoncture évolue au jour le jour, parfois même au fil des heures. Je reviendrai peut-être sur cette question dans un prochain post, mais je voudrais d’ores et déjà prendre trois exemples pour illustrer la complexité de la situation actuelle : les marchés ouverts, les matchs de foot et le Louvre.
Faire du zèle
Dimanche donc, dans l’Oise, le Préfet ordonnait l’arrêt d’un petit marché local tout en maintenant l’ouverture du supermarché situé juste à côté. Scandale ! « Il fallait fermer les deux » proclamait sur LCI l’un des experts dont je parlais plus haut. Poursuivons le raisonnement : les clients du supermarché se seraient alors précipités dans une autre grande surface voisine. D’où afflux de consommateurs, d’où saturation aux caisses, d’où risque supplémentaire, d’où fermeture du 2ème supermarché (en toute logique) ! Était-ce vraiment la bonne décision à prendre ?
Mon hypothèse, c’est que le Préfet – et pas le gouvernement-, seul à décider dans cette affaire, a fait du zèle. Et appliqué à la lettre les procédures en voulant rassurer la population. Quitte, pour ce faire, à prévenir à l’avance les télés (sinon, comment l’auraient-elles su ?). Le problème, c’est qu’il a obtenu le résultat inverse : les clients du marché en ont déduit que la situation était inquiétante voire hors de contrôle. Bref, c’est une erreur de jugement doublée d’une erreur de communication.
Deuxième exemple : le match de foot ce soir entre Lyon et la Juventus de Turin. De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer le huis-clos et/ou l’interdiction des supporters italiens, tout en accusant à demi-mots les pouvoirs publics de céder au « foot business ». Peut-être suis-je un peu naïf, mais je doute que les autorités sanitaires aient pour seule préoccupation des questions d’argent. Nous sommes là typiquement dans une évaluation au cas par cas, et à l’instant T, d’une situation donnée.
En d’autres termes, il s‘agit de prendre une décision à enjeux multiples (médical, mais aussi sportif, socio-économique voire politique) alors que l’on manque d’éléments scientifiques sur les risques réels. Et en ayant bien conscience que si ce match se joue à huis-clos, la cohérence voudrait qu’il en aille de même pour d’autres matchs, pour d’autres sports, pour d’autres villes. Et ce, pour une période indéterminée mais en tout cas de plusieurs semaines, sinon plusieurs mois.
Principe de précaution ou principe d’incertitude
Autant dire qu’entre une décision maximaliste (on arrête tout) et une décision minimaliste (on ne change rien) le choix est cornélien. Mieux vaut, dès lors, accepter l’idée que c’est le principe d’incertitude qui prévaut. Un principe inconfortable certes, difficile à accepter dans notre société d’aujourd’hui qui déteste l’imprévisible, mais qui présente au moins l’avantage de prendre en compte le réel. A savoir que face à une épidémie émergente, tout est nouveau et la seule solution, c’est de s’adapter au fil du temps.
Une chose est sûre en tout cas : en ce mercredi 4 mars (et j’insiste : ce que je dis aujourd’hui ne sera peut-être plus valable dans quelques jours), appliquer dès maintenant le principe de précaution de façon dogmatique, jusqu’à interdire toute rencontre sportive ou à fermer les transports en commun, c’est prendre le risque de provoquer un effet de panique dans l’ensemble de la population. Et de déstabiliser des pans entiers de l’économie. Déjà, les théâtres se vident. Les salons ferment leurs portes. Et les Français dévalisent les rayons des supermarchés et font provision de pâtes comme si la pénurie menaçait – sans réaliser que, du coup, ils provoquent la pénurie !
Je voudrais évoquer, à ce propos, le « droit de retrait » par le personnel du Louvre pour imposer la fermeture du musée. Le motif ? Le nombre de visiteurs quotidien (20 000) supérieur au seuil des 5 000 personnes au-delà duquel le gouvernement interdit toute manifestation publique. Ce à quoi la direction a rétorqué, à juste titre, que ces 20 000 visiteurs n’entraient pas tous en même temps et qu’aucune salle ne pouvait accueillir 5 000 personnes à la fois. Je ne suis pas un spécialiste du droit du travail.
Pour autant, je trouve cette attitude regrettable. Parce qu’elle envoie un bien mauvais signal aux touristes étrangers. Mais, surtout, parce qu’elle sous-entend que les pouvoirs publics ne protègeraient pas les travailleurs alors que les syndicats, eux, s’en préoccuperaient. De quoi alimenter les rumeurs, l’idée que les autorités cacheraient la gravité de la situation. De quoi, aussi, encourager d’autres salariés à brandir ce droit de retrait – je songe notamment aux chauffeurs de bus, qui pour certains agitent déjà cette menace.
Il serait bon de « revenir au réel » comme je le disais plus haut : à ce jour, l’épidémie de coronavirus n’a fait « que » quatre morts. C’est quatre morts de trop, mais ces décès sont à mettre en perspective avec les 9000 morts par an de la grippe ou les 71 000 décès annuels liés au tabac, comme je le rappelais dans un post précédent.
Enfin, cette attitude est déplorable car elle nourrit le fantasme que le danger, ce n’est pas le voisin, le copain, mais c’est toujours « l’autre » (le touriste, l’étranger, le passager du bus, le client de supermarché). Hier soir, dans l’émission de France 2 sur le coronavirus (dont je salue, au passage, l’esprit pédagogique et dédramatisant), un sondage nous apprenait que 67% des Français réclamaient la fermeture des frontières en cas d’épidémie dans un pays voisin.
Oserais-je leur répondre ? Au vu de la situation internationale, si demain cette mesure était adoptée en Europe ou dans le monde, ce serions nous, Français, qui serions interdits de voyager… PS : vous avez été plus de 25 000 à lire mon post précédent sur le coronavirus. Celui-ci est aussi l’occasion de vous en remercier !






